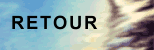TRANSLATE THIS PAGE INTO ENGLISH
avec FreeTranslation.com.
SOURCES
Des mythes ancestraux
Les origines du conte de fées dépassent de loin les fables milésiennes évoquées par Perrault dans la préface de ses contes en vers. Depuis qu’il parle, semble t-il, l’homme raconte. Du moins depuis qu’il écrit, puisque des tablettes de Chaldée nous rapportent la légende d’Étana et de l’aigle. L’Égypte pharaonique avec le Conte du naufragé et le Conte des deux frères conservés sur un papyrus du XIIIe siècle avant notre ère, la Babylonie, la Grèce antique, Rome avec les Métamorphoses (ou L'Âne d'or) d’Apulée présentent des récits dans lesquels se reconnaissent nos contes. De la plus haute Antiquité à la Renaissance, les mythes, légendes et autres fables ont fourni des motifs merveilleux qui se sont retrouvé dans de nombreux contes. Ainsi l’histoire de "Psyché et Cupidon" traverse les siècles pour inspirer La Belle et la Bête des Lumières.
Le XIXe siècle a cru à une origine indo-européenne des contes, ayant constaté les parentés du Pañcatantra indien et de l’Océan des Contes de Somadeva avec nos fables, contes et légendes. En fait les motifs et structures des contes sont universels. Ils se retrouvent en Arabie dans le Kalila et Dimna ou Les Mille et une Nuits. On connaît aussi un Petit Chaperon rouge chinois, des Blanche-Neige kabyle autant que russe, et les contes japonais, khmers, africains, océaniens ou amérindiens nous semblent étrangement familiers
Une tradition orale
Ce conte fut d’abord une parole, transmise de génération en génération, en d’infinies variantes sur des canevas mouvants. Parfois un anonyme modifiait ou inventait, créant un nouveau rameau du grand arbre des contes. Le conte est une poésie de nature, par opposition à la poésie d’art des auteurs, disait Jacob Grimm. L’oralité, c’est la sociabilité : les rares récits anciens décrivant les conteurs et leurs pratiques rapportent généralement des veillées, des mariages, des fêtes : réunions d’une société rurale, où le conte est un rite social et le conteur un passeur entre générations. Figure emblématique, ma mère l’Oye représentée sous les traits d’une vieille femme, est l’un des principaux agents de transmission des contes. Mais c’est le plus souvent un homme, spécialiste du genre, qui porte le conte de ferme en ferme et vit de son "art".
L’auditoire du conteur n’est pas seulement composé d’enfants. En 1548, Noël du Fail nous livre dans ses Propos rustiques les occupations paysannes lors des veillées : "Volontiers après souper, le ventre tendu comme un tabourin, saoul comme Patault, jasait le dos tourné au feu, veillant bien mignonnement du chanvre, ou raccoutrant à la mode qui courait ses bottes, […] chantant bien mélodieusement, comme honnêtement le savait faire, quelque chanson nouvelle, Jouanne, sa femme, de l’autre côté, qui filait, lui répondant de même. Le reste de la famille ouvrant chacun en son office […]. Et ainsi occupé à diverses besognes, le bon homme Robin (après avoir imposé silence) commençait un beau conte du temps que les bêtes parlaient
ORIGINES
Le merveilleux dans la culture médiévale
La littérature médiévale constitue un jalon majeur de l’histoire du conte occidental. Le merveilleux y abonde, inspirant chansons de geste, sagas, fabliaux ou romans et jusqu’aux exempla des prédicateurs.
Fées et prodiges se mêlaient aux hommes au point de peupler leur généalogie et leurs récits d’origine. La légende fait ainsi de la fée Mélusine la souche originelle des Lusignan. Dans les années 1160, Marie de France compose douze lais en vers inspirés des contes populaires bretons auxquels ils empruntent les éléments merveilleux – objets magiques, métamorphoses, loups-garous, fées – et la structure. Cinq siècles plus tard, Mme d’Aulnoy puisera dans le lai d’Yonec la matière de L’Oiseau bleu.
La littérature renaissante emprunte au merveilleux
La rencontre des éléments du merveilleux avec la littérature fut toutefois longue à faire naître un genre particulier. Longtemps fées, sorcières et autres personnages restèrent les comparses occasionnels et non le cadre même des romans ou du théâtre : ainsi des sorcières de Macbeth et des fées du Songe d’une nuit d’été chez Shakespeare, ou des géants de Rabelais. Gargantua fourmille d’épisodes tirés des fabliaux et des contes populaires mais le merveilleux ne constitue pas le cœur du récit. Publiés en 1547, les Propos rustiques de Noël du Fail rapportent les conversations de quatre vieux compères bretons tout en contant les aventures de Maître Renart, Mélusine, des histoires de fées et de loup garou ainsi que celle de "cuir d’Asnette". En 1572, l’une des nouvelles du recueil de Bonaventure des Périers, Contes ou Nouvelles Récréations et Joyeux Devis, s’intitule "D’une jeune fille nommée Peau d’Âne".
Straparola et Basile : deux initiateurs du genre littéraire
Mais c’est en Italie, à la Renaissance, que prend forme le conte merveilleux dans un récit-cadre emprunté au Décameron de Boccace.
Dans les années 1550, le vénitien Straparola fait paraître des Piacevoli Notti, "nuits facétieuses" composées de soixante-treize favole, littéralement fables, plus concrètement contes, parmi lesquels quatorze contes de fées. À Murano, durant la période de carnaval, Lucretia Sforza désigne quotidiennement cinq jeunes filles chargées, chaque soir, de divertir sa cour en racontant une histoire et en la faisant suivre par une énigme. Cinq fables sont ainsi contées chaque nuit sauf durant la dernière nuit où les treize membres de l’assemblée sont invités à intervenir. L’originalité principale des Piacevoli Notti réside dans le fait de livrer les premières transcriptions littéraires de contes populaires issus du folklore paysan vénitien, jusqu’alors exclusivement transmis oralement.
À la suite de Straparola, le napolitain Basile rédige en 1625 Lo Cunto de li cunti, autrement connu sous le nom de Pentamerone. Ce Conte des contes se compose d’un récit-cadre de cinq journées dans lequel sont insérés cinquante contes de fées réunissant l’ensemble des ingrédients du merveilleux : princes et princesses, fées, ogres et magiciens, animaux parlants et objets magiques, désirs d’enfant, épreuves à surmonter et dénouements heureux.
Le conte de fées littéraires comme forme narrative courte est ainsi né de la novella et autre conto italiens. Il faut toutefois attendre le XVIIe siècle pour que naisse un véritable genre littéraire, théorisé par Charles Perrault dans la fameuse Querelle qui l’oppose à Boileau et aux Anciens
La création de contes littéraires se renouvelle au XIXe et au début du XXe siècles : en Russie avec Pouchkine, en Allemagne avec Bechstein, en France avec la comtesse de Ségur, Alexandre Dumas ou George Sand et surtout au Danemark avec Hans Christian Andersen. Si il n’est pas une création proprement dite, le travail des frères Grimm donne une orientation nouvelle au conte de fées. Issus de la collecte des contes traditionnels allemands, leurs Kinder und Haus-Märchen ouvrent la voie aux folkloristes qui, dans les régions, vont inlassablement collecter, classer et étudier ce patrimoine populaire
Andersen, le père du conte de fée moderne
 Un premier recueil de contes d’ Andersen est publié en 1834 sous la forme de deux minces fascicules. Leur succès, immédiat et considérable, encourage Andersen à écrire quelque 173 contes. Véritables créations littéraires dans un style très personnel, ses Contes danois placent le merveilleux au cœur de la société contemporaine et non plus dans un ailleurs irréel. Remarquables par leur ironie et l’absence des morales traditionnelles, ils osent présenter des histoires tragiques et des fins malheureuses, comme La Petit Marchande d’allumette.
Un premier recueil de contes d’ Andersen est publié en 1834 sous la forme de deux minces fascicules. Leur succès, immédiat et considérable, encourage Andersen à écrire quelque 173 contes. Véritables créations littéraires dans un style très personnel, ses Contes danois placent le merveilleux au cœur de la société contemporaine et non plus dans un ailleurs irréel. Remarquables par leur ironie et l’absence des morales traditionnelles, ils osent présenter des histoires tragiques et des fins malheureuses, comme La Petit Marchande d’allumette.
En France, la comtesse de Ségur  se lance dans le genre en l’honneur de ses petites filles Camille et Madeleine. Charles Nodier, André Maurois, Jean Macé, Édouard de Laboulaye, Charles-Robert Dumas écrivent à leur tour des recueils pour enfants qui rencontrent un immense succès. Ces derniers poursuivent la tradition féerique jusqu’à Pierre Gripari qui propose dans les années 1960 des versions parodiques actualisées avec ses Contes de la rue Broca.
se lance dans le genre en l’honneur de ses petites filles Camille et Madeleine. Charles Nodier, André Maurois, Jean Macé, Édouard de Laboulaye, Charles-Robert Dumas écrivent à leur tour des recueils pour enfants qui rencontrent un immense succès. Ces derniers poursuivent la tradition féerique jusqu’à Pierre Gripari qui propose dans les années 1960 des versions parodiques actualisées avec ses Contes de la rue Broca.
Étudier les contes
 Ce sont deux frères allemands qui fondent la science moderne de l’étude des contes : Jacob et Wilhelm Grimm. Ils commencèrent à collecter des contes dès 1807, les faisant lire à leurs amis, comparant les versions. En réaction à la compilation littéraire Des Knaben Wunderhorn de leurs amis Clemens Brentano et Achim von Arnim – somme de contes et chansons populaires arrangés ou réécrits – les deux frères décident de publier en 1812 leur propre recueil de contes : Kinder und Haus-Märchen. Pour la première fois, le principe de fidélité prend le pas sur la mise en forme littéraire.
Recueillis auprès de la "vieille Marie", de Dorothea Viehnamm, des sœurs Hassenpflug et d’un réseau de plus en plus vaste de correspondants, les contes seront progressivement retravaillés, en quête des formes originelles. Cette œuvre littéraire et scientifique fut toujours conçue comme une part de la quête de la vieille culture allemande entreprise par Jacob Grimm, à travers la grammaire, la langue, la mythologie et le droit. Plus de deux cents contes rassemblés lui permirent d’élaborer la première théorie scientifique de l’origine des contes, sur des bases linguistiques aujourd’hui dépassées par la recherche.
Ce sont deux frères allemands qui fondent la science moderne de l’étude des contes : Jacob et Wilhelm Grimm. Ils commencèrent à collecter des contes dès 1807, les faisant lire à leurs amis, comparant les versions. En réaction à la compilation littéraire Des Knaben Wunderhorn de leurs amis Clemens Brentano et Achim von Arnim – somme de contes et chansons populaires arrangés ou réécrits – les deux frères décident de publier en 1812 leur propre recueil de contes : Kinder und Haus-Märchen. Pour la première fois, le principe de fidélité prend le pas sur la mise en forme littéraire.
Recueillis auprès de la "vieille Marie", de Dorothea Viehnamm, des sœurs Hassenpflug et d’un réseau de plus en plus vaste de correspondants, les contes seront progressivement retravaillés, en quête des formes originelles. Cette œuvre littéraire et scientifique fut toujours conçue comme une part de la quête de la vieille culture allemande entreprise par Jacob Grimm, à travers la grammaire, la langue, la mythologie et le droit. Plus de deux cents contes rassemblés lui permirent d’élaborer la première théorie scientifique de l’origine des contes, sur des bases linguistiques aujourd’hui dépassées par la recherche.
ROMANS MERVEILLEUX
Des créateurs d’univers
C’est à partir de 1785, avec les Aventures du baron de Münchausen, que le merveilleux rejoint le roman, avec la reprise du motif des Six Serviteurs. Il n’existe ni genre ni école du roman féerique, mais une série d’œuvres ou d’univers isolés, créés par des auteurs férus de contes de fées, dans cet âge d’or du roman que fut le XIXe siècle. Alors que les contes réduits à des drames réalistes n’avaient jamais cessé d’être employés sous la Révolution et l’Empire, la mode médiévale et fantastique du romantisme explique sans doute la réinsertion des thèmes merveilleux dans les œuvres de Nodier (La Fée aux miettes) et de ses contemporains.
En Angleterre, si La Rose et l’Anneau de Thackeray, paru en 1855, est un long conte, les Waterbabies de Kingsley, en 1863, sont un grand roman clairement qualifié de fairy-tale. Le succès de cette fairy donne naissance à deux univers particulièrement originaux, celui de Lewis Carroll avec Alice’s Adventures in Wonderland et Through the Looking Glass et celui de James Matthew Barrie, Peter Pan in Kensington Gardens et Peter Pan. En Italie, Collodi, adaptateur de Perrault en 1875, publie en 1881 la Storia di un burratino, devenue par la suite Pinocchio.
En France, c’est un auteur parfaitement classique, Anatole France, qui fait planer l’ombre des fées sur Le Crime de Sylvestre Bonnard. Il écrit Les Sept Femmes de Barbe-Bleue et donne une synthèse remarquable sur la nature des contes de fées dans le "Dialogue sur les contes de fées" qui clôt Le Livre de mon ami.
Aux États-Unis, L.F. Baum publie en 1900 The Wonderful Wizard of Oz. Cette production de chefs-d’œuvre romanesques situés dans des univers de féerie semble alors se tarir, peut-être sous l’influence de la crise générale naissante du roman. En un sens, les œuvres de J.R.R. Tolkien, The Hobbit et The Lord of the Rings, avec leur cortège de nains, dragons, elfes et magiciens, referment avec éclat la parenthèse merveilleuse du roman féerique. Après lui, des épigones produisent quantité de romans qualifiés d’heroic-fantasy, bien pâles reflets de ces alchimies. Rowling et Harry Potter ouvre aujourd’hui une autre voie : la parodie du roman merveilleux destinée aux enfants
ESPACE ET TEMPS
Pays de nulle part ou pays proche ?
Les formules traditionnelles " Il était une fois… ", " Au temps jadis… ", placent le conte dans un passé imprécis, aux contours mal définis, hors du temps vécu, du temps historique. Contrée lointaine et fictive, le pays des contes de fées est aussi un monde familier, avec ses villages dominés par le château seigneurial (Le Chat botté) et ses forêts profondes (Le Petit Poucet), ses masures où vivent de pauvres gens (Hänsel et Gretel), ses fontaines et ses rivières auxquelles la tradition populaire attribue un caractère enchanté (Les Fées). Autant de repères qui permettent de situer le conte dans un espace connu.
Le héros quitte un lieu clos pour aller faire sa vie et construire son identité. L’espace du conte se dédouble alors en lieux ouverts que le héros doit parcourir pour, en fin de conte, mieux se retrouver : c’est "le vaste monde" que courent les héros des Contes de Grimm (Les Deux Frères, Le Vaillant Petit Tailleur), où pays inventé, réel et affectif se mêlent pour mieux les égarer.
Le foyer, lieu de départ
Un jour, le héros du conte de fées doit quitter le foyer familial pour partir à la recherche de son identité. Cellule protectrice – comme le palais du fond des océans de la Petite Sirène – ou espace d’emprisonnement – comme la maison familiale de Cendrillon –, le foyer est un lieu clos que le héros doit abandonner de façon volontaire ou forcée, chassé par ses parents (Petit Poucet) ou au contraire après y avoir été maintenu contre son gré (Cendrillon, Peau-d’Âne). C’est la première étape, obligatoire, des pérégrinations du héros, et la condition même du récit. Peau d’Âne s’enfuit du domicile familial afin d’éviter les assauts incestueux de son père. Les parents du Petit Poucet préfèrent abandonner leurs enfants dans la forêt plutôt que d’assister à leur mort lente mais inéluctable. Le cas de Cendrillon, maintenue contre son gré au centre même du foyer, près de l’âtre, dans les cendres, ne fait que conforter cette hypothèse. Mais ici le départ du foyer familial ne peut s’effectuer que contre le vœu des parents. De même, Blanche-Neige, enfermée par sa marâtre dans le château de son père, doit, pour recouvrer son identité, affronter les dangers du vaste monde sylvestre et prouver son bon cœur en se mettant au service des sept nains.
La forêt, lieu d’initiation
Lieu ouvert, sombre et dense, qui inspire la crainte et l’effroi, peuplé d’animaux cruels (loups) et d’êtres barbares qui se repaissent de chair fraîche (ogres), la forêt brouille tous les repères du héros ainsi que ceux du lecteur-auditeur qui retrouve ses terreurs enfantines. Car la forêt renferme bien des pièges, sous la forme d’un asile trompeur comme cette maison de pain d’épices sur laquelle se précipitent Hänsel et Gretel mourant de faim, sans entendre la petite voix de la sorcière qui les prévient, sur le mode de la ritournelle enfantine : "Grigno, grigno, grignoton / Qui grignote ma maison ? "
De même, Blanche-Neige trouve refuge dans la maison des sept nains, mais il s’agit d’un asile factice où sa marâtre a tôt fait de la retrouver. Car la forêt, rarement décrite, est aussi un lieu d’initiation. C’est en la traversant que Blondine échappe au cruel magicien de la forêt des Lilas pour trouver refuge auprès de Bonne-Biche et de Beau-Minon (comtesse de Ségur). Le Petit Poucet, vainqueur par deux fois des pièges de la forêt, en sort grandi et transformé, sinon en taille du moins en maturité. Une nouvelle fois, le héros ne triomphe de l’épreuve que lorsqu’il en sort, c’est-à-dire lorsqu’il trouve le moyen de franchir cet espace faussement accueillant ou franchement hostile
Le château, ou l’apothéose du héros
Le château, preuve matérielle de la réussite du héros, est un lieu préservé du monde extérieur, un lieu de sécurité, signe de la complète transfiguration du héros et de son ascension sociale : c’est le cas pour le château de l’ogre acquis bien rapidement par le faux Marquis de Carabas grâce aux ruses du Chat botté. Au-delà de la consécration sociale et de la récompense accordée à la suite des épreuves surmontées victorieusement, le château symbolise le lieu de l’accomplissement définitif. Cendrillon, Peau-d’Âne, Blanche-Neige, la Belle au Bois dormant, sont récompensées de leur vertu et reçoivent en même temps fortune, gloire et époux dans l’espace consacré du château.
Mais le château peut aussi se révéler maléfique, pour ceux qui brûlent de le connaître de fond en comble. C’est le cas de la Belle au Bois dormant, qui, en parcourant le château familial découvre une vieille fileuse oubliée au fond d’un grenier : négligeant toute prudence, elle se saisit de la quenouille et s’endort pour un sommeil de cent ans. C’est aussi le cas de la femme trop curieuse de Barbe-Bleue qui pénètre dans la chambre interdite, en dépit des menaces proférées par son maléfique et terrifiant époux.
LE HEROS
Le héros est le personnage dominant du conte de fées. Ses aventures constituent le cœur même du récit. Enfant ou adolescent, il est placé au centre d’une situation familiale complexe : bien souvent, le conte règle une affaire de famille. À l’exception des " contes d’avertissement ", dont l’histoire ne se conclut généralement pas par un mariage ou par un bouleversement de la cellule familiale mais par son maintien, la plupart des contes merveilleux mettent en jeu des familles qui se construisent, se modifient, se défont, pour aboutir à une nouvelle organisation à la fin du récit
Un "être de papier" auquel chacun peut s’identifier
Belle princesse accablée par un sort funeste, prince charmant métamorphosé en oiseau, adolescente martyrisée par sa marâtre, cadet mal-aimé par sa famille ou petit enfant abandonné par ses parents, les héros des contes peuvent être comparés à ces figures de cartes, dénuées de toute épaisseur, tels le roi et la reine de cœur qu’Alice rencontre au Pays des Merveilles. Ce sont des "êtres de papier" selon la formule de Roland Barthes autant que des "fonctionnaires de l’intrigue" d’après Claude Brémond. Chacun peut ainsi les imaginer à sa guise et leur variété même permet de s’identifier librement. Désigné souvent à partir d’un détail de sa personne (Blanche-Neige), de son costume (Le Petit Chaperon rouge) ou de son histoire (La Belle au Bois dormant), le héros du conte n’est défini que par les épreuves qu’il doit surmonter. Il s’agit de stéréotypes exposant des situations familiales universelles que chacun peut comprendre. À l’instar du petit Poucet, l’enfant-héros du conte affronte victorieusement le monde des adultes.
Une affaire de famille
Ces affaires de famille exposent les tensions fondamentales et radicales qui existent entre leurs membres. Elle tournent autour des questions de l’identité, de la sexualité et de la propriété. Ainsi, au gré des contes, des parents abandonnent leur progéniture, la dévorent, se sentent menacés ou, au contraire, attirés par eux dans des tentations incestueuses. Des couples se défont, se reconstruisent ou se modifient après de véritables épreuves initiatiques. Des fratries se déchirent, sont mises en concurrence ou sont la proie de malédictions complexes. Héroïnes et héros de basse extraction autant que filles et fils rois connaissent de multiples aventures, dont le dénouement obligé conduit vers un happy end avec en perspective un royaume et beaucoup enfants.
Tous ces thèmes laissent croire que le conte de fées n’est pas destiné aux petits enfants pour leur apprendre que le feu brûle, mais bien aux adolescents qui, de tout temps, encombrent les communautés rurales et posent le problème de leur statut et de leur intégration : adultes non mariés, géniteurs potentiels mais dépourvus de bien ou d’autorité, fratries en rivalité pour la reprise de l’exploitation familiale, célibataires cherchant des partenaires jusque dans les couples mariés… tous adultes potentiels en quête d’une reconnaissance et d’un destin. Les histoires des contes sont donc souvent de véritables exempla de la vie familiale et du passage de l’enfance à l’adolescence. Plus généralement, ils reflètent l’existence humaine et son rapport au temps, c’est-à-dire à la mort, par la mise en scène de la vieillesse et de la succession des générations
La famille apparaît donc comme un thème riche et complexe fréquemment utilisé dans les contes de fées. Elle est une source d’épreuves diverses imposées aux héros, un lieu de rivalités internes entre générations ou entre frères, de désirs tabous et d’interdits à transgresser. C’est en surmontant ces épreuves, parfois par la fuite et l’esquive comme dans Peau-d’Âne, que le héros ou l’héroïne dénouent les fils des sortilèges et construisent leur destin sous forme de mariage idyllique, issue tellement fréquente qu’elle en est devenue le stéréotype identifiant le conte de fées.
LE BESTIAIRE
Animaux fabuleux
De "l’âne qui crotte de l’or" d’Apulée, repris par Perrault dans Peau-d’Âne, à l’oiseau de feu ou l’oiseau d’or des contes populaires russes et allemands, les animaux fabuleux permettent souvent l’enrichissement du héros. C’est le cas de la poule aux œufs d’or que Jack dérobe au Géant de la perche, ou de l’oiseau d’or dont les Deux Frères absorbent le foie, ce qui leur permet de trouver tous les matins une pièce d’or sous leur oreiller. La mort de l’animal est souvent une étape essentielle qui permet au héros de surmonter bien des épreuves : c’est le cas de l’âne que la princesse fait sacrifier par son père incestueux. Princesse revêtue de la peau de l’âne, comme d’un déguisement, elle échappe ainsi aux convoitises paternelles pour attirer celle de son futur époux.
D’autres animaux merveilleux ont pour fonction d’éloigner ou de combattre le héros : ainsi les lions qui gardent la porte du Nain Jaune "avaient chacun deux têtes, huit pieds, quatre rangs de dents et leur peau était aussi dure que l’écaille et aussi rouge que du maroquin" (Mme d’Aulnoy) ; leur aspect effrayant doit frapper les imaginations, tout comme les dragons qui peuplent l’univers fantastique des contes (Les Deux Frères).
Animaux à comportement humain
À la fois semblables aux hommes par leur langage, les animaux s’en distinguent par leur nature : lointain cousin d’Ysengrin, le Chat botté est plus malin que son maître et lui assure sa fortune grâce à ses ruses et à ses bottes : "Ne vous affligez point mon Maître, vous n’avez qu’à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles et vous verrez que vous n’êtes pas si mal partagé que vous croyez" mais par ailleurs c’est grâce à sa nature animale qu’il réussit à manger l’ogre après l’avoir poussé à se transformer en souris. Curieux renversement des rôles !
Quant au loup du Petit Chaperon rouge, il représente un danger bien réel en tant qu’animal dont les campagnes françaises de l’Ancien Régime étaient infestées, mais il personnifie aussi le danger que représente l’homme (et son désir bestial) pour la vertu des jeunes demoiselles innocentes comme l’exprime la moralité du conte de Perrault.
Animaux messagers ou conseillers
Simples animaux du bestiaire traditionnel, sauvés par le héros ou envoyés sur la terre par une puissance occulte mais favorable, ils ont pour fonction d’aider le héros à surmonter les épreuves auxquelles il est confronté. Carpe, corbeau et hibou, tous les trois sauvés par Avenant d’une mort certaine lui permettent de conquérir la Belle aux cheveux d’or (Mme d’Aulnoy ). Les Deux Frères de Grimm "avaient chacun deux lions, deux loups, deux renards et deux lièvres qui les escortaient et les servaient". Souvent, ces animaux "adjuvants" sont au nombre de trois et symbolisent chacun un des trois éléments naturel, comme dans La Reine des abeilles où le cadet sauve la vie à une fourmi, un canard et une abeille, respectivement hôte de la terre, de l’eau et de l’air
Humains métamorphosés en animaux
Il arrive qu’un sort soit jeté pour éprouver l’amour, la vertu ou la fidélité du héros ou de l’héroïne ainsi confrontés à la métamorphose de l’Autre et à son aspect bestial : c’est le cas de l’épreuve imposée à la Bête qui doit convaincre la Belle de l’épouser. C’est aussi le cas de La Chatte blanche qui doit convaincre le prince qu’elle aime de lui trancher le cou (Mme d’Aulnoy). Fées ou enchanteurs sont souvent à l’origine de la métamorphose et ne sont pas à l’abri eux-mêmes des pouvoirs maléfiques de leurs concurrents : la fée Bienveillante et son fils le Prince Parfait se trouvent ainsi transformés en Bonne-Biche et Beau-Minon par l’Enchanteur de la Forêt des Lilas, et ce jusqu’à ce que Blandine prouve sa vertu et sa patience à la Reine des fées, seule capable de lever la punition (La comtesse de Ségur) :
"Il y avait un énorme coussin en satin blanc placé par terre pour Bonne-Biche ; devant elle sur la table était une botte d’herbes fraîches et succulentes. […] En face de Bonne-Biche était un tabouret élevé pour Beau-Minon. […] Le service de table se faisait par des gazelles."
LES PERSONNAGES MERVEILLEUX
Au sommet de la hiérarchie des personnages merveilleux, la fée donne son nom au genre littéraire qui se développe en Europe à partir du XVIIe siècle. Attesté depuis le XIIIe siècle, le terme latin fata est employé couramment pour désigner les Parques romaines ou les Moires grecques, divinités de l’enfer, maîtresses du destin humain
Les fileuses du destin humain
Collectée par les Frères Grimm à l’aube du XIXe siècle, la tradition allemande décrit à peine les fées, se contentant de mettre en valeur leur fonction d’accoucheuses comme le souligne le sens premier du mot "sage-femme" employé par les deux célèbres philologues. "Vieilles comme les pierres", leurs pouvoirs sont ambigus et on doute de leur bienveillance jusqu’au dénouement final.
C’est le cas de la vieille Gardeuse d’oies à la fontaine, qui jette des sorts à ceux qui lui porte assistance ; mais c’est pour mieux permettre à la fille du roi qu’elle protège d’accéder à la maturité. À la fois sorcière et fée, comme pour mieux "rappeler la nécessité des coutumes rituelles par quoi les grands événements de la vie prennent un sens." (introduction des Contes de Grimm par Marthe Robert), garantes du respect des rites, elles les transmettent aux enfants un peu comme ces conteuses auxquelles elles peuvent être facilement assimilées
Les fées de lumière des contes littéraires
"Dame si belle qu’elle ressemblait au soleil. Son habit était tout brodé de paillettes d’or et de barres d’argent".
Le merveilleux se charge d’accessoires avec Perrault ou Mme d’Aulnoy. Ce merveilleux transparaît dans les tenues vestimentaires des fées, chargées de "paillettes", rubis et saphirs ainsi que dans l’éternelle baguette dont elles ne sauraient se séparer. Leurs moyens de locomotion ou les lieux qu’elles investissent sont aussi marqués par l’intervention du surnaturel. Assises dans une coquille de perle (La Chatte blanche), tirées par des coqs d’Inde (Le Nain Jaune), chevauchant des nuages, des globes de feu, ou de somptueux équipages, elles se rendent d’un lieu à un autre "à la vitesse de l’éclair" ou "plus vite que l’air".
Magiciens et enchanteurs
Peu de personnages masculins parmi ces gardiennes du temps et de la mémoire : il semble que jeter des sorts, transmettre un rituel ou initier au passage d’un âge à un autre soit plutôt le fait de personnages féminins. Mais les princes ont parfois besoin d’un parrain et il existe quelques magiciens et enchanteurs dont la fonction est souvent de combattre ou de déjouer les pouvoirs de leurs consœurs. Ainsi "l’ami enchanteur du Roi Charmant" qui combat la puissance maléfique de la fée Soussio en aidant le roi, métamorphosé en Oiseau bleu à recouvrer son aspect d’origine ainsi que l’amour de la belle Florine.
Cependant, fées et magiciens peuvent être maléfiques, à l’instar des sorcières, comme la Fée du désert ou l’Enchanteur de la forêt des Lilas qui maintient Bonne-Biche et Beau-Minon sous sa coupe
La sorcière, double maléfique de la sage-femme
De la sage-femme à la sorcière il n’y a qu’un pas aisément franchi dans les contes allemands : ainsi la sorcière qui invite Hänsel et Gretel leur apparaît-elle au premier abord comme une charmante grand-mère qui leur offre "du lait et de l’omelette au sucre, des pommes et des noix" dans sa maison de pain d’épices. Mais ce n’est qu’une ruse pour attirer les enfants et les manger. Car la sorcière est aussi un peu ogresse. Ce qui est aussi le cas de Baba-Yaga, la grand-mère sorcière des contes russes populaires, qui vit dans la forêt et "croque les gens comme des poulets" :
"Sa maison d’ossements était faite, des crânes avec des yeux ornaient le faîte, pour montants de portails des tibias humains, pour loquets ferrures des bras avec des mains et en guise de cadenas verrouillant la porte, une bouche avec des dents prêtes à mordre. […] Baba-Yaga monta dans son équipage et fila bon train. Dans son mortier elle voyage, du pilon l’encourage, du balai efface sa trace." (Vassilissa-la-très-belle). Avec son mortier et son pilon lui servant à broyer les destinées humaines tout en effaçant les traces de son passage parmi les hommes, Baba-Yaga est donc bien une fileuse de destinées, une initiatrice qui offre à Vassilissa le moyen de se défaire de sa marâtre : un crâne aux yeux ardents qui consument la méchanceté.
LES OBJETS MAGIQUES
Des vecteurs du merveilleux
Dans l’univers des contes de fées, le monde des objets est investi d’une intensité particulière, comme si l’anonymat imposé aux personnages profitait aux objets : ces derniers apparaissent vivants, hauts en couleur, à coup sûr doués d’une âme. L’enchantement s’y propage au rythme vigoureux des "alors" qui scandent les péripéties d’une intrigue riche en actions. Déployés dans le visible, magnétiques, en proie à une logique autonome, les objets semblent les conducteurs privilégiés du merveilleux.
"Va, prince, lui dit la fée, en le touchant trois fois avec le rameau d’or, va, tu seras si accompli et si parfait, que jamais homme devant toi ni après toi, ne t’égalera". Alors, le rameau d’or, avatar luxueux de la baguette, opère la métamorphose qui met l’apparence du prince en accord avec la beauté de son âme. Autour de lui s’organise, dans le conte du même nom, l’intervention d’une cascade d’objets aux vertus stupéfiantes tels que le tire-bourre d’or qui ouvre magiquement la vieille armoire aussi "vieille et laide par dehors" que "belle et merveilleuse par-dedans", le livre merveilleux découvert par le Prince Torticoli dans sa chambre de la Tour des Princes Rebelles, ou le portrait de la Fée Bénigne qui pare la Princesse Trognon d’une beauté nouvelle (Mme d’Aulnoy).
Chapeau du Prince lutin qui lui confère à sa guise l’invisibilité, clé envoûtée de Barbe-Bleue dont le sang ne s’efface pas, miroir enchanté de Blanche-Neige ou de La Belle et la Bête qui révèle des vérités invisibles ou lointaines ("Quelle fut sa surprise, en jetant les yeux sur un grand miroir, d’y voir sa maison où son père arrivait avec un visage extrêmement triste…"), écharpe de toile d’araignée que la Fée Carabosse lance sur les épaules de la Fée Printanière "brodée d’ailes de chauve-souris" et qui semble clouée sur ses épaules, œufs magiques de L’Oiseau Bleu ou bottes du Petit-Poucet qui s’ajustent à la jambe de celui qui les enfile et permettent de parcourir sept lieues en une seule enjambée : innombrables et divers sont les objets qui remplissent, dans le conte, l’espace de la réalité et le temps de l’épreuve.
Des objets complices ou maléfiques, accélérateurs de l’histoire ?
Mais si tous les objets, doués ou non de pouvoirs magiques, participent à l’accélération – ou au ralentissement – de l’histoire (on pense à la quenouille fatale de la Belle au Bois Dormant), certains y contribuent à titre de complices, tandis que d'autres opposent la résistance de l'obstacle. "Bons" ou "mauvais" objets ne cessent de s’affronter et de faire exister en miroir deux mondes qui sont l’inverse l’un de l’autre. Emblématique à cet égard est le combat qui oppose dans La Princesse Printanière le chariot d’or des bonnes fées où une belle dame tient une lance dorée, et le chariot attelé de six chauves-souris où une femme laide brandit une vieille pique rouillée, ou dans Le Rameau d’or, la confrontation entre la demeure des araignées, des chats suppliciés et de la haine, et l’amour qui habite la Tour des Princes Rebelles (Mme d’Aulnoy).
Les objets médiateurs de l’invisible
Plus largement, c’est à une méditation sur le bon usage de tous les objets que le conte nous invite à réfléchir, opposant à une logique d’accumulation aveugle (parce qu’elle ne voit dans les objets que leur dimension visible), le discernement du regard qui sait entrevoir au-delà des apparences, la véritable richesse qui est bien celle du cœur. Ainsi dans Cendrillon l’empressement fiévreux des sœurs qui réclament avidement à leur père de beaux habits et des pierres précieuses contraste avec le détachement de Cendrillon demandant à son père le premier rameau qui heurterait son chapeau, se situant ainsi du côté de ce qui ne "brille" pas mais existe avec le statut d’une promesse (Grimm). Tout se passe comme si, en choisissant un objet qui est du côté de la vie (le rameau verdoyant), Cendrillon mobilisait à son secours toutes les énergies vitales et leur prodigieux pouvoir de métamorphoser instantanément l’infiniment petit en infiniment grand. Tout se passe comme s’il y avait toujours deux mondes en présence : un monde où ce qui est difficile vient d’abord, où l’épreuve et la perte sont structurantes et opèrent les "bonnes" coupures et par ailleurs un monde fastueux d’abord mais qui va se rétrécissant et dont l’enflure finit par conduire à l’auto-mutilation, ou à la "mauvaise" coupure.
Ainsi organisés en systèmes, les objets constituent dans les contes de fées une forme d’écriture en miroir, qui fait durer le temps de l’épreuve et lui confère sa matérialité : une matérialité ambiguë puisqu’elle nous met en chemin vers un espace autre, situé au-delà des apparences, dans l’invisible et agissante vérité des cœurs.
LA MORALE DE L'HISTOIRE
De quoi parlent les contes ?
Les contes de fées parlent de la quête de l’amour et de la richesse, du pouvoir et des privilèges qui l’accompagnent, et surtout du chemin qui permet de sortir de la forêt et de retrouver la sécurité et la quiétude du foyer. Ramenant les mythes sur terre et leur imprimant un tour humain plutôt qu’héroïque, ils donnent un caractère familier aux histoires conservées dans les archives de notre imaginaire collectif. Qu’on pense au Petit Poucet, image en miniature de David tuant Goliath, d’Ulysse aveuglant le Cyclope, de Siegfried terrassant Fafner. Les contes de fées nous entraînent dans une réalité familière au double sens du terme — à la fois profondément intime et centrée, non pas sur les enjeux du monde en général, mais sur la famille et ses conflits.
À qui s’adressent les contes ?
L’ambiguïté du public destinataire du conte de fées littéraire est au cœur de l’œuvre de Perrault : morales adultes, préfaces à visées éducatives, œuvres réputées pour enfants. Un siècle plus tard, les frères rassemblent des récits clairement enracinés dans l’univers des adultes, si l’on considère les préoccupations et les ambitions des principaux personnages. La Belle au Bois Dormant, dans le conte de Perrault, se conduit peut-être comme une enfant étourdie et désobéissante lorsqu’elle se saisit de la quenouille qui va la plonger dans un profond sommeil, mais ses véritables ennuis commencent lorsqu’une marâtre jalouse entend se la faire servir "à la sauce Robert". Riquet à la houppe nous enseigne que l’amour transfigure l’être aimé et que la noblesse de caractère l’emporte sur la beauté physique. Barbe-Bleue, avec sa chambre interdite où sont enfermés les cadavres d’anciennes épouses, traite de la loyauté, de la fidélité et de la trahison conjugales, et montre que le mariage est hanté par la menace du meurtre. Raiponce s’attache aux dangereuses envies d’une femme enceinte et montre qu’il est vain de vouloir protéger la vertu d’une fille en l’enfermant dans une tour.
Si les post-adolescents sont avides de contes qui explorent les rituels de séduction et les affaires conjugales, les enfants sont plutôt attirés par ceux qui éclairent leurs propres faiblesses. La peur d’avoir faim, l’angoisse de la séparation, les terreurs nocturnes, la hantise d’être abandonné et dévoré : tels sont les grands enjeux de leur existence. Contrairement au conte de fées classique dont le cheminement va de la désintégration d’une famille sérieusement perturbée à la fondation d’une nouvelle union baignant dans la félicité, les contes de fées pour enfants ramènent leurs héros et leurs héroïnes chez eux, éliminant le plus souvent le méchant parent fauteur de troubles ou présentant des parents sincèrement contrits et ivres de joie lorsque leurs enfants reviennent à la maison. Dans Hänsel et Gretel des frères Grimm, les enfants se jettent au cou de leur père, devenu veuf entre-temps. Les parents du petit Poucet se "réjouissent" de son retour et l’accueillent "à bras ouverts".
S’adressant à un public qui ne se limite pas aux enfants, le conte de fées constitue une fonction d’apprentissage.
Le conte, un moyen thérapeutique ?
Depuis quelques dizaines d’années, les pédopsychologues voient dans les contes de fées un formidable moyen thérapeutique susceptible d’aider enfants et adultes à résoudre leurs difficultés en réfléchissant sur les conflits incarnés dans ces histoires. Le texte devient un adjuvant permettant au lecteur de surmonter ses peurs, de s’affranchir de ses sentiments hostiles et de ses pulsions destructrices. En explorant le monde des fantasmes et de l’imagination, en allant jusqu’au bout de conflits anxiogènes, l’individu affronte ses peurs, les maîtrise et s’en libère. Plus globalement, la véritable magie du conte de fées réside dans sa capacité à transformer la souffrance en plaisir. En donnant corps aux fantasmes de notre imagination sous forme d’ogres, de sorcières, de cannibales et de géants, les contes de fées suscitent l’effroi, pour le voir aussitôt vaincu par le plaisir de sa représentation
 Retour Page Précédente
Retour Page Précédente
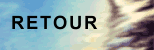
page principale
Sources : BNF


 Un premier recueil de contes d’ Andersen est publié en 1834 sous la forme de deux minces fascicules. Leur succès, immédiat et considérable, encourage Andersen à écrire quelque 173 contes. Véritables créations littéraires dans un style très personnel, ses Contes danois placent le merveilleux au cœur de la société contemporaine et non plus dans un ailleurs irréel. Remarquables par leur ironie et l’absence des morales traditionnelles, ils osent présenter des histoires tragiques et des fins malheureuses, comme La Petit Marchande d’allumette.
Un premier recueil de contes d’ Andersen est publié en 1834 sous la forme de deux minces fascicules. Leur succès, immédiat et considérable, encourage Andersen à écrire quelque 173 contes. Véritables créations littéraires dans un style très personnel, ses Contes danois placent le merveilleux au cœur de la société contemporaine et non plus dans un ailleurs irréel. Remarquables par leur ironie et l’absence des morales traditionnelles, ils osent présenter des histoires tragiques et des fins malheureuses, comme La Petit Marchande d’allumette.
 se lance dans le genre en l’honneur de ses petites filles Camille et Madeleine. Charles Nodier, André Maurois, Jean Macé, Édouard de Laboulaye, Charles-Robert Dumas écrivent à leur tour des recueils pour enfants qui rencontrent un immense succès. Ces derniers poursuivent la tradition féerique jusqu’à Pierre Gripari qui propose dans les années 1960 des versions parodiques actualisées avec ses Contes de la rue Broca.
se lance dans le genre en l’honneur de ses petites filles Camille et Madeleine. Charles Nodier, André Maurois, Jean Macé, Édouard de Laboulaye, Charles-Robert Dumas écrivent à leur tour des recueils pour enfants qui rencontrent un immense succès. Ces derniers poursuivent la tradition féerique jusqu’à Pierre Gripari qui propose dans les années 1960 des versions parodiques actualisées avec ses Contes de la rue Broca.
 Ce sont deux frères allemands qui fondent la science moderne de l’étude des contes : Jacob et Wilhelm Grimm. Ils commencèrent à collecter des contes dès 1807, les faisant lire à leurs amis, comparant les versions. En réaction à la compilation littéraire Des Knaben Wunderhorn de leurs amis Clemens Brentano et Achim von Arnim – somme de contes et chansons populaires arrangés ou réécrits – les deux frères décident de publier en 1812 leur propre recueil de contes : Kinder und Haus-Märchen. Pour la première fois, le principe de fidélité prend le pas sur la mise en forme littéraire.
Recueillis auprès de la "vieille Marie", de Dorothea Viehnamm, des sœurs Hassenpflug et d’un réseau de plus en plus vaste de correspondants, les contes seront progressivement retravaillés, en quête des formes originelles. Cette œuvre littéraire et scientifique fut toujours conçue comme une part de la quête de la vieille culture allemande entreprise par Jacob Grimm, à travers la grammaire, la langue, la mythologie et le droit. Plus de deux cents contes rassemblés lui permirent d’élaborer la première théorie scientifique de l’origine des contes, sur des bases linguistiques aujourd’hui dépassées par la recherche.
Ce sont deux frères allemands qui fondent la science moderne de l’étude des contes : Jacob et Wilhelm Grimm. Ils commencèrent à collecter des contes dès 1807, les faisant lire à leurs amis, comparant les versions. En réaction à la compilation littéraire Des Knaben Wunderhorn de leurs amis Clemens Brentano et Achim von Arnim – somme de contes et chansons populaires arrangés ou réécrits – les deux frères décident de publier en 1812 leur propre recueil de contes : Kinder und Haus-Märchen. Pour la première fois, le principe de fidélité prend le pas sur la mise en forme littéraire.
Recueillis auprès de la "vieille Marie", de Dorothea Viehnamm, des sœurs Hassenpflug et d’un réseau de plus en plus vaste de correspondants, les contes seront progressivement retravaillés, en quête des formes originelles. Cette œuvre littéraire et scientifique fut toujours conçue comme une part de la quête de la vieille culture allemande entreprise par Jacob Grimm, à travers la grammaire, la langue, la mythologie et le droit. Plus de deux cents contes rassemblés lui permirent d’élaborer la première théorie scientifique de l’origine des contes, sur des bases linguistiques aujourd’hui dépassées par la recherche.







 Retour Page Précédente
Retour Page Précédente